VI FIGURE ET TEXTUALITÉ
Les figures
Un texte peut aussi être accompagné de figures, que l’on appelle aussi, par anglicisme « images ». Qu’est-ce qu’une figure ? Ce peut être tout élément visuel non textuel, ni hypertextuel, accompagnant un texte. Ce peut être tout aussi bien une lettre dans la mesure où elle na pas seulement fonction d’objet logique au sein d’une police.
Une figure peut très bien être composée d’un ou plusieurs caractères. Ceux-ci seront alors affichés pour leurs aspects plastiques. Ne fonctionnant pas au sein d’une police, ils ne sont plus à proprement parler des caractères ; ils n’en possèdent pas toutes les propriétés. Une figure peut être encore une image, descriptive ou illustrative, un schéma, un élément décoratif, et bien d’autres choses.
En quoi les figures font-elles ou ne font-elles pas partie du texte ? En règle générale, une figure n’est pas reproductible par les mêmes moyens que le texte qui l’accompagne. Une figure peut être dessinée au sein d’un texte avec la même plume. Les Cahiers de Paul Valéry en sont un exemple. Dans d’autres cas, la figure a une existence plus autonome.
Elle peut exister ailleurs, dans un autre ouvrage, ou ne même pas exister encore, être une photographie que l’auteur envisage de prendre, par exemple. Dans ce cas, sa place pourra être indiquée dans le corps du texte par une annotation qu’on pourra proprement qualifier d’hypertextuelle, qu’elle soit manuscrite, imprimée ou numérisée.
Parfois l’image peut se trouver au sein de l’ouvrage, mais pas dans le corps du texte, sur une page tirée à part, et à laquelle une annotation renvoie ; à moins, au contraire, qu’associée à l’image, une autre annotation textuelle ne renvoie à la partie du texte auquel la figure est liée, comme dans la plupart des ouvrages d’André Breton.
Les fonctions que peuvent avoir les figures
1. Une figure peut être descriptive ou explicative. Elle prend le relais du texte, qui devient alors incomplet, peut-être indéchiffrable, sans elle. C’est le cas, par exemple, de figures explicatives accompagnant un manuel. Les figures appellent alors une lecture au même titre que le texte.
2. Les figures peuvent être redondantes. Le texte serait lisible et compréhensible sans elles, mais elles lui ajoutent un surcroît d’évidence, ou d’émotion. C’est souvent le cas des photos de presse ou des illustrations d’ouvrages pour la jeunesse.
3. La figure peut être en décalage avec le texte. Ni elle ne s’y intègre comme un élément lisible, ni elle ne l’illustre. Elle intervient sur le sens entier du texte. C’est souvent le cas du dessin humoristique et de sa légende.
4. La figure peut enfin avoir une fonction de ponctuation. C’est le cas des frises qui ornaient la fin des chapitres de livres anciens, ou encore des lettrines. C’est celui, plus moderne, de titres décoratifs, ou d’images, ou encore d’aplats et de textures, qui n’ont manifestement pas d’autre fonction que d’articuler les parties de la page.
On pourrait assimiler cette fonction de ponctuation à une fonction décorative, qui lui est naturellement inhérente. En fait elle assure principalement une « respiration » du texte, comme la ponctuation permet de reprendre son souffle. Quand elle ne participe pas ainsi à la lisibilité, c’est qu’elle est défectueuse.
Figures et caractères
En réalité, nous n’avons que des figures. Les caractères ne sont eux-mêmes que des figures regroupées en polices.
Pour l’informatique, une police est une valise contenant un certain nombre de figures à laquelle correspond une touche ou une certaine combinaison de touches du clavier. C’est à dire qu’à chaque figure associée à une touche ou une combinaison de touches, elles-mêmes associées à un nombre binaire, correspond un caractère en tant qu’objet logique, qui peut ainsi être réitéré autant de fois qu’il est nécessaire pour composer un texte. C’est exactement ce que nous essayons de faire le plus lisiblement possible quand nous écrivons à la plume : nous reproduisons le plus fidèlement possible les mêmes figures.
Nous voyons donc que les caractères ont une triple nature. La première est celle d’objets logiques. La lettre “a”, par exemple, est la première lettre de l’alphabet latin. En soi, elle n’a pas de forme spécifique, elle peut s’écrire de quantités de façons, et l’on pourrait changer d’alphabet, comme le firent les Turcs, sans que sa fonction linguistique ne soit modifiée. Elle n’a pas de forme phonétique bien nette non plus, puisque sa prononciation varie selon les langues naturelles ou selon les lettres qui l’accompagnent. Bref, ses caractéristiques physiques sont aussi contingentes que celles des pièces du jeu d’échecs. Elle fonctionne seulement comme signe à contenu nul dans le système de la langue.
Elle peut être aussi prise comme symbole : celui du premier item d’un ensemble, celui d’une variable dans une équation… Elle peut symboliser tout ce qu’on veut lui faire symboliser.
Elle peut enfin être considérée comme une forme plastique. À ce moment là, mon “a” est essentiellement une forme colorée sur une surface. Celle-ci peut être numérisée, soit comme un ensemble de vecteurs et de courbes associées à des couleurs, soit comme une carte de cette surface découpée en suffisamment de points assez petits pour être imperceptibles à l’œil nu, et auxquels je peux associer des couleurs avec un nombre plus ou moins élevé de nuances. Dans le premier cas, ce sera une figure vectorielle, dans le second, une figure bitmap.
Police et objet logique
J’ai défini la police par rapport au texte ; je vais maintenant la définir pour elle-même. Chaque caractère représente un signe faisant partie d’un ensemble complet, et fonctionnant selon les règles de cet ensemble.
La forme des caractères est contingente. Elle n’a d’autre fonction que de permettre de le distinguer des autres éléments de l’ensemble, dans la mesure où les caractères sont des signes qui ne renvoient pas des signifiés, comme des concepts, mais à des objets logiques n’ayant ni existence physique, ni existence conceptuelle, ni aucun contenu, seulement des propriétés combinatoires.
Nous remarquerons que le même objet graphique peut avoir trois statuts et trois mode de fonctionnement distincts. Il peut fonctionner comme un caractère (objet logique), comme un symbole (sémantique, logique, numérique), ou comme une figure (objet plastique, ou esthétique).
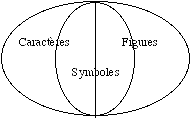
Qu’est-ce qu’une police pour l’informatique ?
Une police est une valise contenant des figures bitmap ou vectorielles. Ces figures sont généralement des caractères, mais pas toujours. Elles ne sont parfois que des collections de symboles ou de figures, qui ne sont reliées entre elles par aucune règle de langage.
Pour l’informatique, il n’y a pas de différence entre les deux, qui sont indifféremment appelées « polices » : « polices de caractères » ou « polices de symboles ». Chaque police est de toute façon composée de figures.
En fait, l’informatique ne connait qu’une double division : figures bitmap ou vectorelles, qui peuvent être autonomes ou regroupées en polices.
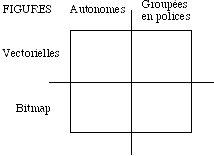
de 16 fichiet html associés à une feuille de style (text1.css)
et d'un dossier "graphics" contenant 15 fichiers,
réunis dans un fchier txt_fr, que l'on peut librement télécharger.
© Jean-Pierre Depétris, avril 2002, avril 2003
Copyleft : cette oeuvre est libre, vous pouvez la redistribuer
et/ou la modifier selon les termes de la Licence Art Libre.
Vous trouverez un exemplaire de cette Licence sur le site Copyleft
Attitude http://www.artlibre.org ainsi que sur d'autres sites.
Adresse de l'original : jdepetris.free.fr/what_a_text/txt_fr/text0.html