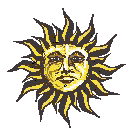
À Dirac
Jean-Pierre Depetris, octobre 2025.
Le ciel est descendu à terre. Les nuages ont recouvert la ville aujourd’hui. Je prise peu cette saison, ni assez froide, ni assez chaude. Elle parvient pourtant à se faire parfois d’une réelle beauté.
En sortant de la maison, je marchais dans la brume ; du haut du campus maintenant, une mer de nuage a fait disparaître la ville.
Dirac sans Dirac ne manque pas de charme. Oui, c’est bien Dirac toujours. Il n’est plus que la citadelle en face. Même le minaret de la grande mosquée est noyé.
Des plaques de lumière tombent sur la mer de nuage, dont des bouts cotonneux se détachent pour courir sur le flanc des montagnes ; des plaques de lumière à peine un peu cuivrées.
Le soleil vient de percer pendant que je finis mon café. « Je t’apporte les félicitations du recteur », m’annonce Sharif en s’asseyant en face de moi. « Il croit savoir », répond-il à mon regard surpris « que tu appliques bien ses nouvelles directives. »
J’avoue n’en rien connaître. « Il paraît que tu encourages efficacement des étudiants de lettres, à s’orienter vers les mathématiques et les sciences de l’ingénieur », m’explique Sharif. « Oui, j’avais oublié de te les transmettre. »
L’idée me paraissait simplement s’imposer que l’étude des humanités fait trop souvent l’impasse sur elles, et aux étudiants aussi j’imagine. C’est comme faire se tenir l’esprit sur un seul pied.
« Les États-Unis ne manquent pas de pétrole », m’a déclaré Sharif quand nous avons inévitablement commencé à parler de l’état du monde. « Ils ont seulement besoin de ne pas céder le contrôle du marché pétrolier aux Brics. Ils menacent donc le Vénézuéla. »
« Il est peu probable qu’ils se risquent à une attaque, les Brics ne le permettront pas », dis-je. « Cependant, s’ils ont déplacé tant de moyens, et que malgré tout la république bolivarienne reste en place, ils l’auront eux-mêmes considérablement renforcée. »
Elle grouille déjà de présences militaires ou paramilitaires russes, iraniennes et chinoises, comme l’Ukraine d’intervenants de l’Otan. L’occasion est ainsi offerte à la Fédération de Russie de réagir enfin aux lignes rouges allègrement franchies, comme s’en inquiétait Sinta. Le bruit court que la flotte russe est déjà dans les Caraïbes.
« Le Vénézuéla est bolivarien, plus encore que chaviste », conclut Sharif. « Le gouvernement a fait distribuer des armes au peuple, ce qui prouve qu’il ne le craint pas. »
Devant la cafétéria, dans un petit carré de verdure bordé de briques, quelqu’un a jeté quelques pommes-de-terre qui ont commencé à germer. Si elles tiennent et qu’elles ne sont pas coupées, elles donneront de jolies fleurs blanches au printemps.
Sanpan et moi prenons un dernier verre dans le restaurant de bois où il m’a raccompagné de l’université en voiture.
– Tu as un physique de lutteur, Sanpan. As-tu déjà pratiqué ?
– Oui, quand j’étais jeune, j’ai été champion.
– C’est la lutte traditionnelle telle que la pratiquent les peuples du Nord-Ouest ?
– Non, c’est la lutte gréco-romaine, celle qui se pratiquait à Athènes, celle des Perses, en réalité. Tu as dû entendre parler dece que l’on appelait les « maisons de force » ? C’était comme le Gymnase d’Athènes, l’on n’y pratiquait pas seulement le sport, mais la musique et les mathématiques aussi.
– Oui, je connais, mais je ne savais pas que l’usage s’en était répandu si loin du foyer originel perse. L’empire a toujours contenu des peuples avec des mœurs diverses.
– C’est vrai, et des ethnies et des cultes variés, mais avec de fortes racines communes. Cette lutte se pratique aujourd’hui surtout entre l’Ouzbékistan et le Kazakhstan. Tu as dû remarquer que les lutteurs ont souvent des types asiatiques. C’est le fréquent brassage des invasions et des migrations.
– Tu as toi-même des traits asiatiques : les yeux un peu bridés, les cheveux raides…
– Et le corps trapu… Tu sais qu’elle est devenue aujourd’hui une discipline olympique dans laquelle les Iraniens se distinguent particulièrement.
– Je suis surpris que tu conduises pourtant ta voiture comme un vieux pépère.
La nuit tombe autant en nous que sur le lac.
Je ne prise pas trop la saison, mais j’aime ses crépuscules. Ceux de l’automne ont des vertus curieusement pénétrantes. Le jour se couche littéralement en vous.
Vous ressentez la nuit venir en vous avec une prégnance fantastique. J’aime sentir la nuit tomber en moi.
Je ne sais comment il est possible d’avoir toujours quelque chose à dire. Je n’avais jamais dit qu’en novembre, la nuit tombait en nous, je ne l’avais jamais entendu dire par quiconque, pourtant c’est vrai.
N’est-il pas possible, un jour, que l’on parvienne à avoir tout dit ? Voilà, tout a été dit : l’on ne peut plus qu’attendre du nouveau.
Que vais-je trouver aujourd’hui que je n’aie encore jamais dit ? Non, je ne joue plus. Le monde est trop intarissable.
Les nouveaux quartiers à la sortie nord de la ville, là où s’achèvent les derniers contreforts de l’Hindou Koush avant les plaines de la Transoxiane, offrent un aspect auquel on ne s’attendait pas tout de suite après que les travaux eurent été achevés. Ils sont fortement végétalisés : de véritables jardins suspendus.
De nombreux éléments sont en bois : balcons, vérandas, quelques parties de façades… L’intérieur des appartements l’est aussi quelquefois, je l’ai vu en passant chez Sariana et Farzal.
Des plantes grasses d’altitude sont plantées sur des corniches ; et des arbres plus grands, dans de faux balcons, des cèdres, jusque sur les toits, et des sapins, des ifs… Ils ne sont pas très hauts encore, mais ils le deviendront.
L’on en remarque mieux alors les boiseries qui décorent les façades et les balcons. Il en résulte un style qui n’est semblable à aucun que je connaisse, bien différent de ce qui se fait aujourd’hui en Orient, où les fréquents immeubles végétalisés répondent surtout à un souci de se protéger des chaleurs excessives du Sud-Est, et les essences y sont tropicales. Ce n’est pas le souci ici ; seulement la beauté.
Les choix architecturaux de la nouvelle ville me rassurent. Je craignais qu’elle ne contrastât trop avec l’ancienne ; qu’elle ne dénonçât la vétusté de nombre de ses bâtiments, qui me paraît parfois délibérément entretenue. Le bois et la végétation font l’harmonie.
C’est un trait que partage tout l’Orient moderne, comme l’Orient ancien avant lui. L’on y est prêt à tous les surcoûts pour répondre au seul souci de beauté. Il n’est pas d’architecte sérieux qui y fasse exception : où que l’on soit, dès que l’on ouvre ses volets, ce que l’on voit doit être beau.
Il ne s’agira pas de beauté facile et spectaculaire, quoique les grandes villes chinoises y cèdent parfois, avec leurs diodes électroluminescentes qui s’éclairent la nuit sur les façades pour y dessiner des motifs mouvants. Non, l’on prise plutôt la beauté tranquille, celle qui rend heureux au réveil.
La grande mosquée, si blanche, et si belle sous la neige quand la rivière est gelée, marque maintenant l’entrée de la nouvelle ville. Maintenant l’on y a une meilleure vue par l’arrière sur son dôme qui n’était pas aussi bien mis en valeur.
Les rues en pente de Dirac se font belles avec le soleil rasant de la saison. J’aime particulièrement un boulevard qui grimpe raide vers la citadelle. Il est large et il offre une vue sans encombre sur les maisons et les jardins qui s’étalent en désordre sur ses hauteurs, déjà en contre-jour.
« Tu ne peux pas imaginer combien la ville était différente dans mon enfance » me dit Sinta, avec laquelle nous nous y sommes arrêtés pour un thé à la menthe. Il est dur de l’imaginer dans les vieux quartiers, tant elle paraît n’y avoir pas bougé. Je sais cependant combien les changements tiennent souvent à peu de choses.
J’imagine que l’on ne devait pas voir tant de vélos ni de trottinettes électriques. Les vêtements aussi ont bien changé. Les femmes portent toujours de longues robes et se coiffent d’un foulard. Pourtant, en comparant avec les vieilles photos, on les trouve plus élégantes aujourd’hui. Colorés, leurs vêtements l’étaient déjà ; l’on aimait déjà les bleus sombres imprimés d’azur pâle, comme la couleur des chardons secs au bord des routes quand l’été a été chaud. Les hommes aussi semblent plus élégants sans que l’on sache dire pourquoi. L’épicier de la station ressemble toujours plus à un vacher de l’Ouest américain, avec sa barbe et son chapeau, et sa chemise de flanelle à carreaux bleus et noirs.
La vérité est que je ne connais du passé que des photos noir et blanc, et non des vidéos en couleur. L’on a la même surprise en comparant des peintures impressionnistes avec les premières photographies de l’époque. Quand sur les unes le monde rayonne, sur les secondes, il est triste et sale. Les femmes de Dirac marchent avec tant d’élégance et de légèreté qui n’étaient pas rendues ; et les gens d’ici ont un tel sens de la couleur.
« Oui », je réponds à Sinta après avoir promené mon regard autour de moi, « que vois-tu de changé ? »
Je pense que transporter sur soi de minuscules ordinateurs de poche, susceptibles de vous mettre en contact avec n’importe qui où que ce soit ; qui vous permettent d’accéder à toutes les bibliothèques du monde et de les consulter n’importe où, ou bien encore de suivre à tout instant votre travail en cours…, tout cela est de nature à changer tout ce que vous voyez depuis si longtemps autour de vous.
L’Ouest sauvage s’imagine sottement que cela serait de nature à vous y faire renoncer sans regret. La vérité est plutôt le contraire : vous y serez d’autant plus attachés que vous vous en sentirez moins prisonnier.
J’ai deux plumes. Il n’est pas facile de les reconnaître en me lisant, pas toujours. Chacune donne à sa façon une impression de spontanéité. Ma première épouse la parole. J’écris vite les mots les uns après les autres sans beaucoup réfléchir. Cette plume-là offre parfois des fulgurances et des suites d’idées qui me surprennent. L’autre fonctionne une peu comme on écrit des équations : je me sers principalement de la syntaxe pour penser. J’écris vite encore, et je n’hésite pas à réécrire, à rajouter des mots entre les lignes, à tracer de longues flèches vers des rajouts, où marquer des appels de notes numérotées qui renvoient à la suite des pages.
L’on cesserait rapidement de s’y retrouver. Il m’est parfois nécessaire de recopier de longs passages un peu plus loin. Cette plume offre également des fulgurances et des suites d’idées qui me surprennent. Elles doivent tout à la grammaire, dans le sens où l’on dirait que le langage des mathématiques fait le calcul a votre place.
Plus de temps est nécessaire pour apprendre à se servir de cette seconde plume. Elle engendre des répétitions, l’on doit souvent changer de temps et de modes. Il n’est pas simple de se rendre attentif à ce que l’on a réellement écrit plutôt qu’à ce que l’on voulait dire.
Le correcteur grammatical automatique se fait précieux alors, mais l’on doit s’en méfier. Il est rare que je reprenne les corrections telles qu’elles me sont suggérées, même lorsqu’il ne s’agit que d’accords de nombre ou de genre. Elles me révèlent plutôt des imprécisions sous-jacentes. Souvent, il me suffit de changer la ponctuation, un terme, ou encore le temps ou le mode d’un verbe, ou le nombre d’un substantif, et le plus souvent, je reconstruis la phrase.
Il devient plus difficile encore de ne pas se laisser distraire de ce que l’on écrit réellement par ce que l’on pensait vouloir dire. Ces ajustements aiguisent toujours la pensée ; ils la construisent, et font surgir des évidences surprenantes. L’on imagine le plaisir que l’on y trouve.
Pour tout cela l’on souhaiterait de bons outils, des plumes dont le métal crisse vigoureusement. L’époque est singulière, qui offre des ordinateurs de poche à vil prix, mais ne sait plus produire des stylos dans lesquels l’encre ne sèche pas.
Les sophistes se donnaient pour mission d’enseigner la sagesse. En ces temps-là, cela désignait surtout la physique et la géométrie. Aussi, ce que l’on a pris coutume d’appeler le sophisme était d’abord une méthode d’enseignement. Tout laisse croire qu’elle se voulait une méthode accélérée, abrupte.
Licos a entrepris par ce matin glacé et ensoleillé de m’expliquer ce que fut le sophisme. Des sophistes, il nous est peu resté. Nous connaissons bien mieux ce que furent leurs héritiers musulmans, les motasaouf, les soufis. L’on ne mesurera jamais assez le rôle qu’ils ont joué pour faire pénétrer les peuples qui découvraient le Coran dans ses subtilités.
« La méthode sophiste, j’ai envie de te la décrire en disant qu’elle prétend faire disjoncter le raisonnement logique. Aussi elle est une voie rapide ; elle dissout les explications compliquées. » L’idée intéressante est qu’elle ne visait pas de leur substituer des explications plus simples, mais pas d’explication du tout.
L’arme du sophiste est le paradoxe. Licos m’a parlé de celui de Zénon d’Élée, qui montre le héros Achille incapable de rejoindre une tortue à la course ; arrivant toujours en retard au lieu où elle se trouvait avant qu’elle ne se déplace encore aussi peu que ce soit, selon la logique implacable du calcul infinitésimal.
Je connais Zénon d’Élée, et ses autres paradoxes, quoi que je ne sache pas qu’il était un sophiste. Son maître Parménide, avait prouvé l’impossibilité-même du mouvement. Socrate le réfuta en se levant et en marchant.
Il m’était apparu assez tôt que tous les paradoxes mathématiques reposent sur la mauvaise formulation des énoncés. Le problème est que l’on ne peut pas tout demander à des énoncés. L’on passerait une vie à les reformuler pour s’assurer qu’ils ne donnent pas naissance à de nouveaux paradoxes.
L’on ne doit donc jamais trop se fier aux énoncés, et c’est le premier enseignement de la sagesse.
J’ai été plusieurs fois surpris à considérer comment des gens simples, frustes et sans instruction, parvenaient à s’approprier des idées et des pratiques aussi complexes que subtiles. Je n’ai pu voir comment cela s’accomplit dans des temps anciens, mis j’ai les cheveux suffisamment blanchis pour en avoir encore été témoin avec l’idée communiste, et, presque en même temps, les techniques du moteur à piston.
« Mes lectures d’Élisée Reclus et de Piotr Kropotkine m’y ont ouvert l’esprit », me confie Maryam. Nous nous voyons souvent Maryam et moi. Youssef son bien-aimé la laisse trop seule, comme je le lui reproche souvent, bien que je sache qu’ils sont très proches, et que même sans être physiquement ensemble, ils partagent profondément ce qui les occupe chacun de son côté.
Ce matin, j’ai pris des chaussettes bleu sombre avec des chaussures au ton clair et un pantalon gris. Je ne souhaitais pas me lever pour en chercher d’autres. Je ne me serais jamais permis une telle faute de goût, quand j’étais moins fatigué pour me lever. Mes réflexions sur ce dont je fus le témoin, viennent de me le rappeler, moi qui ferais bien de relire les auteurs que Maryam vient de me citer, si ce n’est lire enfin certains de leurs ouvrages.
J’ai parlé avec Mariam de la conversation que j’ai eue avec Licos à propos du sophisme. Nous soupçonnons qu’une posture semblable a bien dû se glisser dans la façon dont le communisme s’est transmis. C’est une question fascinante que de se demander comment des gens dont tout laissait croire qu’ils s’engageaient dans une voie bien trop raide, se sont hissés au plus haut de l’esprit.
Je ne peux m’empêcher de penser à Joseph Dietzgen, parti comme simple apprenti tanneur, devenu un philosophe qui me tient à cœur avec son Essence du Travail Intellectuel Humain, et un courageux communiste, remplaçant les martyrs du Premier mai de HayMarquet à la direction du journal Freiheit qui avait appelé à la grève. Le prophète Jésus s’était choisi des disciples qui étaient tous de cette veine, plutôt que des érudits ou des courtisans, et qui surent porter leur mission mieux que nul autre. Combien parmi tous sont demeurés inconnus.
J’espère que Sinta n’aura pas remarqué mes chaussettes. Je la sais comme moi attentive à discerner dans les infimes détails les prémices d’une voie à ne pas suivre.
© Jean-Pierre Depétris, octobre 2025
Copyleft : cette œuvre est libre, vous pouvez la redistribuer et/ou la modifier selon les termes de la Licence Art Libre. Vous trouverez un exemplaire de cette Licence sur le site CopyleftAttitude http://www.artlibre.org ainsi que sur d’autres sites.
Adresse de l’original : http://jdepetris.free.fr/Livres/Dirac/