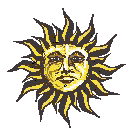
Sint II
Jean-Pierre Depetris, août 2023.
En cette saison, l’on ne sait jamais comment s’habiller. Si l’on se couvre, l’on a trop chaud, et quand on se découvre, on a froid. Je regarde mes mains, et je suis surpris des traces de coups et d’écorchures. Ce n’est pourtant pas mon stylo ni mon clavier. On dirait des mains de métallo. Me revient le temps où je travaillais dans des chantiers. Je n’y ai pas travaillé si longtemps dans le cours de ma vie. Ils étaient une façon rapide de gagner de l’argent, en sachant que je pourrais arrêter sans problème quand le chantier serait fini. Un travail plutôt agréable, et je dirais même reposant quand on est jeune. Oui, les premiers jours étaient souvent épuisants si l’on s’était arrêté longtemps, mais une semaine ou un mois plus tard, la souplesse et les muscles étaient revenus. L’on ne se fatigue plus si l’on retrouve les bons gestes, et l’on se tient en santé.
Ce n’est donc pas parce que j’ai travaillé dans des chantiers de métallurgie que je me prends pour un ouvrier. Je suis un ouvrier des lettres. Je ne le dis pas parce que je maîtrise tous les procédés de reproduction, de la presse à bras à la publication assistée par ordinateur. Mon véritable outil est la plume, aujourd’hui la pointe-gel, et je m’en sers comme un ouvrier.
Articuler des périodes et les pages d’un livre n’est pas si différent qu’organiser des dispositifs mécaniques. C’est le même principe ; c’est seulement plus difficile car l’on ne bénéficie plus de l’admirable support que se fait pour l’esprit la chose inerte. La remplace la consistance de la parole et du sens. Dans tous les cas, toujours doit se générer, circuler et se décupler l’énergie. C’est comme la mécanique.
Tu me trouves un air brutal quand j’écris : je rature, je barre, je fais de longs renvois, je vais vite, mais ne t’y trompe pas, un cordonnier est énergique quand il frappe avec son marteau, mais il demeure un tranquille artisan. Le principe reste le même : économiser l’effort, pas les gestes.
J’ai besoin de travailler tranquillement en ne pensant à rien d’autre. Je ne supporte pas d’être dérangé, ni qu’on me bouscule. J’ai plaisir à planifier ce que je fais et à m’installer dans le temps : une chose après l’autre, énergiquement sans doute, mais sans me presser.
Je suis ainsi en tout. Sinta a appris à s’en accommoder. Ce n’est pas évident, il en résulte peut-être un mode de vie trop bien réglé. C’est mon côté vieux garçon.
On économise sa force mais pas ses gestes. Retiens cela. J’ai travaillé un jour avec un jeune homme qui n’avait encore jamais mis les pieds sur un chantier. Il me dépassait d’une tête et il était bâti comme un culturiste. Nous avions des câbles de pinces-à-souder à ranger. Quand un chantier est fini, ils restent sur place, entremêlés comme des fils au fond d’une boîte-à-couture. Ils sont lourds et plutôt rigides ; l’on doit donc procéder patiemment pour défaire l’un après l’autre leurs méandres croisés. L’homme était jeune et fort ; il commença par ne pas écouter mes conseils, me jugeant sans doute trop lent à multiplier des gestes dont il pensait que sa force le dispensait. Au bout d’une heure, il n’avait pas avancé beaucoup et suait à grosses gouttes. Il croyait que la force parvient à bout de la terrible hostilité de la chose inerte. Elle n’y réussit jamais. Seul l’esprit y parvient. Il fait mieux : il s’en sert. Il en fait sa propre force.
Retiens ce que je dis, c’est une loi de ce monde. Je ne suis pas allé aux confins de l’espace et je ne sais ce qu’on y trouverait, mais ici, c’est ainsi.
La conversation que nous avons menée hier a si bien intéressé Maryam, qu’elle a continué à m’interroger.
Comment puis-je passer de mon expérience du travail à une conception révolutionnaire et internationaliste de la lutte des classes ? Ce n’est pas compliqué si l’on prend le bon bout. Ce n’est même pas sans une certaine évidence.
Les mouvements ouvriers qui ont marqué l’époque moderne et contemporaine reposent sur l’observation triviale que les ouvriers sont dépossédés par la propriété privée des moyens de production. Ils sont, littéralement, des prolétaires, et quand on les définit ainsi, l’on ne comprend pas ce qui les ferait devenir le ferment d’une société future.
Pour les propriétaires, les travailleurs ne sont que des prolétaires. Mais que sont-ils pour eux-mêmes ? C’est l’enjeu du Communisme : comment passer de cette conscience en creux, à se concevoir comme les maîtres dans l’art de puiser dans la chose inerte la toute puissance de l’esprit ?
Que vaut la propriété en regard de cet art, qu’elle soit privée, ou publique ; qu’elle soit celle des richesses naturelles, celle de moyens productifs, ou même des procédés ? Elle ne s’applique qu’à des artefacts éphémères que le travail produit, transforme et renouvelle.
– Je crois comprendre, en t’écoutant, une chose que je n’avais encore jamais remarquée, m’interrompt Myriam. Il me semble que l’on ne s’attarde pas à définir si cette conscience nouvelle doit être le chemin qui conduise à l’expropriation des classes propriétaires, ou bien l’inverse : si cette lutte économique et sociale ne serait pas plutôt la voie qui ouvrirait la porte à un tel état de conscience, l’entraînant dans une civilisation nouvelle.
– On peut le dire ainsi, à condition d’être prudent avec le terme de civilisation. Civilisation est un substantif qui ne s’emploie efficacement qu’au pluriel. Il est possible de l’utiliser au singulier dans le sens où tout ce que l’une produit finit par se retrouver chez les autres, et seulement dans ce sens. En cela, la lutte des classes est trans-civilisationnelle, ou pour le dire plus simplement, internationaliste.
Le temps est bien gris. J’ai su que de la poussière de sable est encore en suspension dans les nuages, et elle rend la pluie terreuse.
Je le trouve triste, même si je me dis que j’ai toujours aimé ce temps encore doux de l’automne. Il exalte des odeurs de terre et d’herbe humides. Le monde y ressemble à des estampes faites sur du papier de riz à l’encre de Chine par un mouilleur détrempé.
Le monde en devient plus délicat que sous l’azur assourdissant des ciels d’été.
Ce temps est riche de sensualité, et l’espace plus dense que ne le rend le bleu étouffant et vide.
Je dois avoir la sensualité un peu triste aujourd’hui.
« Ces jours-ci, presque tous les commentateurs étaient convaincus que l’entité sioniste, c’est-à-dire les États-Unis, allaient attaquer l’Iran. Pas moi, j’étais sûr du contraire. Il est plus facile d’avoir des certitudes lorsqu’on n’est pas personnellement impliqué ; l’on n’est pas assailli par des “et si…”. »
« Ma certitude reposait sur la simple arithmétique : De combien de missiles disposent les USA ? Combien l’Iran ? Les État-Unis sont incapables de fournir à la fois l’Ukraine et les Israéliens. »
« D’autre part, si la première raison ne suffisait pas, l’on ne saurait où frapper. L’Iran est un immense pays, montagneux et forestier. Si l’on songe à depuis quand la Fédération bombarde l’Ukraine avec bien plus de moyens, qu’espéreraient les USA face à une défense anti-aérienne bien supérieure ? »
« Attends, ce n’est pas fini », répond Sanpan à Shimoun.
« Je crois bien que si », renvoie ce dernier.
« Tu crois qu’ils ont lancé tant de menaces pour ne rien faire ? » demande Sinta.
« Ils commettront bien quelque crime de guerre dont ils ont le secret, aussi répugnant que spectaculaire, et stratégiquement insignifiant, » admet Shimoun.
« Tu vois, ce qui rend la situation imprévisible, est que la Fédération de Russie et l’Iran sont intimement alliés et partagent de nombreuses visions à long terme, mais alors que l’un est ennemi de l’entité sioniste, l’autre s’en fait plutôt le protecteur. Sa survie se négocie entre eux. »
Mes camarades ne me semblent pas avoir l’esprit au travail. Moi non plus en fait. Je me prends plutôt à la contemplation des nuages si nombreux, dont le ciel immense laisse pourtant tant de place à l’azur.
Ce matin, j’avais en tête quelques réflexions sur la double articulation des langues humaines, et sans percevoir encore bien où elles me conduisaient, j’imaginais qu’avaient peut-être été sous-estimées ses implications logico-mathématiques. Je crois que ce sera pour un autre jour.
Je me résous donc à laisser momentanément ces profondes idées en suspens pour me joindre à la conversation. « L’Ouest est tombé dans un piège. Il se referme avec une fascinante et terrible lenteur. Il se l’est tendu tout seul. Personne n’aurait su le tramer et l’y entraîner. Comment les maîtres de Washington et leurs succursales européennes n’ont-elles rien vu ? »
« C’est comme si un démon avait pris le monde en main, et contraint chacun à improviser, mais avec des intelligences inégales. Même la Fédération de Russie s’est montrée plus d’une fois dérouté, certes non par l’imagination ni l’audace de son adversaire, mais plutôt par ses absurdes inconséquences. »
« Les ventriloques de Washington ont choisi de curieuses marionnettes : le comique de Kiev déguisé en Kermit la Grenouille, et celui de Tel-Aviv avec son nom de clown : des personnages dignes de Stephen King pour ce conte d’horreur. »
« Les peuples du monde n’avaient jamais connu les images des massacres ni des génocides qui avaient frappé leurs civilisations ; maintenant, à travers celles du Moyen-Orient, ils les voient quotidiennement en direct. Nul ne sait ce qu’il en retournera. »
« C’est exactement la remarque que j’ai lue sous la plume du professeur Mouhammad Marandi », révèle Sinta en me prenant sur le fait d’avoir omis de le citer.
Marandi est un excellent analyste iranien. (Chez eux aussi, l’on semble aimer afficher ses titres universitaires – la dernière forme d’aristocratie de nos jours.)
Moi : Je ne me souviens jamais à quel point est bonne une macédoine de légumes ; des légumes de notre jardin surtout. La terre y est bonne. Toutes ne sont pas égales à engendrer des saveurs. Qu’est-ce qu’il fait encore chaud ! Je suis content que tu sois venue déjeuner avec moi. Je trouve triste de manger seul.
Maryam : Youssef travaillait encore avec Shaïn. J’aurais dû aussi déjeuner seule.
Moi : J’aurais plus le goût de travailler dans les chantiers de Shaïn que de donner des cours.
Maryam : Pourquoi t’en priver ?
Moi : Il me l’a proposé, mais je suis trop vieux.
Maryam : Tu disais pourtant que tout repose dans l’art de puiser dans la chose inerte et hostile sa propre force.
Moi : Il y a ce que l’on dit, et il y a ce que l’on fait.
Maryam : « Économiser l’effort, mais pas les gestes », disais-tu. J’avais compris que la force n’est rien et que tout est dans l’art de s’y prendre.
Moi : c’est exact à un point stupéfiant, mais cela demande une discipline stricte. On en perd l’habitude à ne pas l’exercer.
J’ai aussi perdu de ma dextérité, car, ne t’y trompe pas, il ne suffit pas d’économiser ses efforts ; encore les gestes pour les éviter doivent-ils être justes. Sans la pratique, l’esprit lui-même se grippe.
Maryam : Peut-être est-ce ce qui provoque cette baisse de quotient intellectuel dont nous parlions le mois dernier. Pourtant il me semble que toujours plus de monde pratique des exercices physiques les plus divers.
Moi : Ce n’est pas la même chose. L’on cultive son corps, mais hors de ses actions sur les forces inertes qui l’environnent. Travailler, ce n’est pas se faire les muscles ; ce serait comme le contraire.
Ces haricots, ces petits-pois, ces carottes ont des saveurs inoubliables, et que pourtant j’oublie chaque fois.
Il fait encore chaud en milieu de journée, au point de devoir ouvrir le parasol pour déjeuner au soleil. Les aurores, elles, sont glacées, comme les crépuscules. Quand le jour s’est couché, l’air tiédit légèrement. L’on sait bien tout cela, mais l’on a toujours plaisir à le dire.
Je souhaitais interroger Youssef sur la façon dont ils travaillent. En attendant, j’ai interrogé Maryam. J’avais cru comprendre que l’on devait être à la fois savant et manuel. L’on doit tout connaître des éléments, leurs propriétés électromécaniques et chimiques. Ils fabriquent tout, employant l’égoïne, le tournevis de précision, le lourd palan…, cernés par des tableaux couverts d’équations. Comment pourrais-je leur être utiles ?
« Je crois qu’il n’est pas nécessaire d’être si savant ni athlète. Tu dois d’abord être ingénieux, et bien sûr polyvalent. »
« Tu vois, mon problème n’est pas seulement d’avoir perdu beaucoup de mes aptitudes, il est que je n’en ai pas tant acquises. »
Les État-Unis ont fini par attaquer l’Iran. Je me demande pourquoi ils gaspillent leurs missiles dont ils sont tant à court, quand l’Iran est bardé de S 400 qui ne laissent rien passer. Le monde entier a vu le ciel de Téhéran grâce aux ordinateurs de poche, où l’on suivait les missiles abattus les uns après les autres. J’ignore si quelques-uns sont passés, je n’en ai pas vus. Quelque chose est tombé sur la ville, qui semblait être un débris, et qui avait causé un incendie. Rien qui ne rappelât les bombardements de Londres par le Troisième Empire. Alors pourquoi le quatrième expose-t-il sa faiblesse sous les yeux du monde entier ? Non, je ne ris pas. C’est plutôt tragique.
Le sionisme se sent menacé. Les Palestiniens, les Arabes, possèdent une arme qui assurera leur victoire finale : la démographie. Alors les sionistes se défendent comme ils le peuvent en exterminant leur progéniture. Non, je ne ris pas. Les ventriloques de Washington ne m’amusent pas. Ils me donnent des cauchemars : je m’éveille parfois agité dans l’obscurité de la chambre. L’esprit travaille la nuit, et rappelle le souvenir d’odeurs de cadavres.
C’est la guerre. Quelle guerre ? La guerre mondiale bien sûr. Pourtant aucune n’est déclarée. Seuls les État-Unis et la Corée sont formellement en guerre, mais ils ne se battent pas.
Qui cherchent à faire rire les ventriloques de Washington ?
L’entité sioniste prétendait bien accomplir une frappe de décapitation. Le projet aurait été modifié suite à une fuite qui a fait grand bruit. Les Iraniens avaient pris connaissance du détail des plans de vol obtenus par les État-Unis. L’on dut se rabattre au dernier moment sur du simple et du vite fait.
Cet épisode dit beaucoup du désordre qui règne à Washington. L’Ouest génocidaire n’a pas de véritable tête. C’est un problème car ni l’Iran, ni la Fédération de Russie, ni aucune autre nation, ne sait avec qui négocier.
Une communauté qui a besoin d’un chef pour lui dire ce qu’elle doit faire, aux personnes, aux groupes, aux institutions…, est sur une mauvaise pente ; mais tout groupement humain a besoin de représentants pour négocier avec d’autres groupements. Quand les fidèles sont entrés en Mésopotamie, les Perse leur ont demandé : « Qui est votre khalife ? » Ils voulaient dire « Qui est autorisé à parler en votre nom ? » Les fidèles ont désigné leur khalife, et le nom vient de là.
L’Ouest sauvage n’a pas de khalife, ni les État-Unis, ni ses provinces. Avec qui négocier ? Avec le locataire de la Maison Blanche, celui qui va déménager bientôt ou celui qui le remplacera ? Avec la Commission Européenne ? Avec les présidents, chanceliers ou autres premiers ministres des pays membres de l’Union Européenne ? Seraient-ils investis de l’autorité de parler pour l’ensemble, l’on ne serait pas convaincu qu’ils fissent des interlocuteurs sérieux ?
Le chef de l’OTAN n’a quant à lui aucun pouvoir de décision ; il doit s’en remettre aux membres de l’alliance. Celle-ci d’ailleurs n’est pas formellement en guerre, et peut-on négocier la paix quand on n’est pas en guerre ?
Personne n’a l’autorité de décider d’un recul des bases nucléaires de la frontière russe. Elles constituent pourtant aussi une menace pour l’Europe entière. Le danger est évident pour tous les peuples du continent.
Ce danger, quand j’étais jeune encore, entraîna des foules dans les rues alors que les premières bases devaient être installées en face du Pacte de Varsovie, plus loin à l’ouest où les Russes exigent qu’elles soient maintenant repoussées. Voilà la principale pomme de discorde, si j’ai bien suivi.
L’Ouest s’agite sans tête, comme les poules de Sinta après qu’elle la leur a coupée.
© Jean-Pierre Depétris, août 2023
Copyleft : cette œuvre est libre, vous pouvez la redistribuer et/ou la modifier selon les termes de la Licence Art Libre. Vous trouverez un exemplaire de cette Licence sur le site CopyleftAttitude http://www.artlibre.org ainsi que sur d’autres sites.
Adresse de l’original : http://jdepetris.free.fr/Livres/Sint_II/