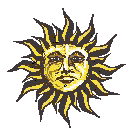
Sint II
Jean-Pierre Depetris, août 2023.
Cela m’arrive chaque fois que je passe d’une chose à l’autre, par exemple tenir mon journal et relever mon courrier. Je lance alors un jeu sur mon écran, un tout petit jeu, pas question d’y passer une plombe, un démineur ou un morpion. C’est une façon de réinitialiser mon attention.
Souvent j’en lance un autre, ou plusieurs à la suite. Je ne m’inquiète pas d’y passer trop de temps. Ce n’est pas le cas. Ils ne sont que de tout petits jeux. Ils me prennent moins de temps que si j’étais sorti boire un café, ce qui m’arrive aussi. J’ai besoin d’interruptions.
Pendant que je joue, souvent me viennent en tête des airs idiots, des musiques de foire, tubes surannés. Les uns entraînent les autres. Il se crée alors dans mon esprit une sauce compacte faite de débris mnésiques : jeux, musiques, etc., qui s’enchaînent ; qui m’enchaînent plus qu’ils ne libèrent mon esprit. Je m’en inquiète depuis que je m’en suis rendu compte. Ce ne doit pas être bien sain.
M’inquiète surtout comment leur ensemble s’agrège malgré moi.
(Nous y perdons certainement un contrôle ; nous nous habituons à le perdre. Nous ne le perdrions pas en sortant prendre un café.)
Sinta se félicite de son nouveau Huawei. Je crois que c’est le meilleur ordinateur téléphonique. J’aurais aimé en acheter un, mais pas question de remplacer ce qui marche encore, et pour ce que j’en fais.
Les Chinois sont parvenu à fabriquer leurs puces. Qui en avait douté ? Leurs clients russes n’auront plus à prendre celles de leurs machines-à-laver pour les placer sur leurs missiles, comme tentait de nous le faire croire grotesquement la propagande occidentale.
Le temps a bien refroidi et je ne suis pas mécontent de m’habiller de saison : blouson de daim, veste de laine, chaussures montantes et bien étanches. L’on ne se sent plus tout à fait le même à travers les différentes saisons, autant changer aussi son apparence.
Où que je sois allé, les ciels sont merveilleux en novembre. Je parle bien sûr de l’hémisphère nord, et au-dessus de l’équateur. La forme des nuages et leurs couleurs, la délicatesse des bleus, sont saisissants, serrés en lignes, leur passage des plus sombres au céruléum le plus pur, serrés en lignes parallèles par l’étirement en lointains filaments. Cela produit les plus profondes impressions sur l’esprit, et justement celle de profondeur, d’horizontalité infinie que rend plus sensible encore la fraîcheur sur nos sens.
J’en ai déjà parlé : je n’aime pas ce moment des premiers jours de novembre, quand le soleil atteint le centre de la constellation du scorpion. J’y perçois je-ne-sais-quoi de maléfique. Je peine à aller me coucher, je dors mal, et j’en ressens la fatigue. Ces premiers jours passés, et ils le sont, je suis saisi par la beauté des ciels.
Je me suis fortement attaché à la ville de Dirac, à ses longs ateliers aux murs aveugles sous le ciel de novembre. Le monde y apparaît curieusement lointain, le monde familier d’abord.
J’aime longer des ruisseaux dans la campagne. « Je n’ai pas pris la voiture pour ne pas m’obliger à revenir où je l’aurais garée », dis-je à l’homme qui m’a pris en stop. « Vous trouverez facilement une voiture pour vous prendre au retour ? – Bien sur, les gens sont gentils à Dirac », lui réponds-je dans la langue locale.
Les ruisseaux, les rivières ont cette mauvaise habitude d’avoir souvent leurs rives envahies de buissons et d’arbustes, rendant difficile de les longer en regardant leur eau. Celui-ci en a peu, sa pente étant très faible. Il a près de ses berges beaucoup de mares et de terrains spongieux où poussent quelques joncs. Ses bords sont accessibles, et pendant l’été, il doit être agréable de s’y baigner. Il nous faudrait y venir Sint et moi. Ce ruisseau est profond et a peu de courant.
Un pont en bois le traverse à quelques centaines de mètres en aval, assez solide en apparence pour supporter une voiture, quoiqu’il branle un peu quand j’y marche.
Vue du pont, le soleil déjà rasant sur les branches fait paraître l’eau plus profonde. Je frissonne à l’idée qui m’était venue de me baigner. Le temps et l’horaire serait plutôt à la pêche.
Il n’est pas difficile d’aller se perdre en pleine campagne à Dirac, quoique je ne sois pas très loin en fait. Je pourrais aisément rentrer à pied, jusqu’à une ligne de transport en commun au moins. Il est si beau de voir le jour tomber derrière les vitres d’un car.
Ces derniers temps, Sinta ne porte pas toujours son voile. C’est nouveau. Personne ne lui en fera des remarques, pas même les femmes de notre génération. Les plus jeunes n’ont pas attendu : il y a longtemps que plus d’une n’en portent plus.
Sinta a coutume de teindre ses cheveux, et je comprends qu’elle ressente une frustration à se mettre en frai si personne ne contemple son ample chevelure d’ébène.
J’en suis surpris cependant, mais je ne lui ai rien demandé. Je ne l’ai jamais questionnée non plus sur ses raisons d’en porter un. J’ai toujours imaginé qu’elle n’aurait pas su me répondre. C’est comme si l’on me demandait pourquoi je porte la barbe. Je ne le sais pas moi-même, ou bien je ne sais plus. Ce sont des questions d’enfants. Elles inspireraient au mieux des réponses convenues.
J’espère qu’elle ne va pas se faire couper les cheveux courts. Là j’interviendrais certainement. Ses longs cheveux de jais, avec quelque-chose de bleuté, sont si beaux. Ils tombent autour de son visage comme un voile, comme un écrin pour ses yeux si noirs, avec pourtant quelque-chose de vert.
Il n’est plus possible de déjeuner dehors sous le saule devant la maison. C’est dommage quand nous recevons nos amis. La grande pièce chez Sinta paraît bien petite dès huit personnes. Il y avait le vieux Shimoun avec ses lunettes épaisses ; il y avait Sanpan avec sa carrure de lutteur, accompagné de sa femme ; il y avait Sharif avec Nadina, maintenant docteur ; il y avait Licos, le seul qui ne participe pas de plein droit à notre séminaire, quoiqu’il y intervienne quelquefois, et qui soit un francisant honorable.
Je suis passé maître dans l’entretien du feu chez Sint, dont je sais maintenir la température. Je me suis donc assis, lui tournant le dos, à une extrémité de la table dont nous avons tiré les rallonges.
Sharif nous a parlé d’un Bureau International de la Langue Française, association constituée récemment pour la protéger des institutions nationales. Le français n’appartient plus en effet aux seuls nationaux. À ce compte, les Québécois seraient plus sérieux, qui tiennent « patate » pour un anglicisme et ont un génie pour former de nouveaux mots pour de nouveaux usages.
« Pour ma part », dis-je après avoir ajouté une bûche, « je suis surtout inquiet de la part que prend la loi dans le champ de la linguistique. »
« Je critique moins le désir de légiférer sur les usages linguistiques », réponds-je aux premières questions. « J’observe plutôt que l’on demande toujours plus aux législateurs de définir le sens des mots. En d’autres temps, ces derniers seraient allés demander eux-mêmes aux grammairiens et autres spécialistes, de définir les mots dont ils se servent. »
« Je comprends », dit Licos, « J’avais entrepris de tout savoir sur ce qui distinguait les saveur et les propriétés d’un produit. Le décaféiné, par exemple : L’on fait disparaître la caféine pour conserve la saveur. Comment ? De quoi s’agit-il ? J’ai trouvé des informations à satiété sur les règlements qui légifèrent les saveurs, mais rien de pratique, de technique, de concret. C’était la question que je me posais. »
« C’est bien cela », dis-je, « pour vaper, je mélange moi-même des extraits de nicotine avec des saveurs de tabac préalablement séparés, aussi absurde qu’il y paraisse. Quand je m’interroge, ce ne sont pas les réponses des législateurs qui m’intéressent. »
« Où voulez-vous en venir ? » demande Sharif. »
« Je crois que si nous généralisons ce qu’ont observé nos collègues », répond Shimoun à notre place, « Nous verrons là un vrai danger pour la langue et la pensée. Vous ne le voyez pas ? Ce ne sont pas les experts de la langue que les législateurs devraient interroger, ce sont ceux qui savent tout des objets et de leurs usages à propos desquels ils légifèrent »
– As-tu demandé à Sint pourquoi elle ne porte plus son voile quand elle ne va pas à l’université ?
– Non Sharif, dis-je en souriant intérieurement, me souvenant de ce que j’écrivais hier soir dans mon journal.
– J’espère que tu n’y es pour rien.
– Bien sûr que non ! Sinta n’est pas une femme qu’on influence. Dis-moi Sharif, tu ne serais pas un peu conservateur ?
– Le progrès est conservateur, fait-il péremptoire.
– Je retiens ton paradoxe, dis-je cette fois un riant.
– Nul ne progresse, continue-t-il, s’il ne conserve ce qui était avant lui.
Sharif doit encore être sous l’influence de nos échanges antérieurs. J’ai observé que les progressistes sont les plus conservateurs en matière de langue.
– Je ne te contredirai pas sur ce point, mais admets avec moi qu’il n’est pas mauvais de faire quelquefois le ménage. Quand c’est cassé on n’y peut rien. On doit jeter ; mais, tu me connais, tu sais alors combien j’hésite.
Depuis le début de la semaine, le ciel est nuageux, mais toujours le soleil le perce. Il chauffe agréablement quand nous allons prendre dehors un café.
Le ciel reste chargé et le sol est humide. J’aurais dû prendre un chapeau, le soleil frappe fort sur mon front.
Dans des gouttières, des herbes sont restées vertes. Elles y ont à satiété de la lumière et de l’eau. Je vais rester encore pour contempler les nuages qui sont aujourd’hui d’une délicatesse extrême. Les hautes falaises en face en paraissent glacées d’humidité.
L’on découvre des qualités et des détails dans la vie quotidienne qui méritent d’être observés avec la plus grande attention. Ce sont eux précisément que l’extrême étirement des nuages sur l’horizon font paraître plus distants.
Le soleil maintenant n’est plus qu’un cercle de mercure dont l’éclat vacille sur un fond gris mouvant.
Les rivières sont grosses. J’observe attentif leurs débits. L’eau est souvent boueuse et tourbillonnante. Il est probable qu’il pleuve plus souvent en altitude.
J’aime les villes de montagne qui surplombent le pays alentour. J’aime particulièrement les villes fortifiées. Quelquefois je vais promener autour de la citadelle. Assez peu souvent car la marche est rude, mais elle réchauffe en cette saison.
L’architecture militaire est belle, surtout je crois car elle n’a aucun souci de beauté. Même ici où les constructeurs ne négligent aucune occasion de décorer la pierre de calligraphies, aussi sobres soient-elles. L’architecture militaire n’a qu’un souci : épouser intimement le terrain, s’insinuer dans ses irrégularités, les accentuer, tirer le moindre parti d’un promontoire, longer une faille. Elle magnifie ce que le sol possède déjà de défensif, en soulignant les abrupts naturels. C’est beau. Toujours.
Certaines parties de la forteresse ont été laissées libres d’accès. On a loisir de circuler sur ses chemins de ronde, de traverser ses postes de guet aux pierres épaisses et plonger le regard à travers leurs meurtrières devenues inutiles ; et la vue de là-haut sur la ville est sans obstacle. Nous la voyons de plus haut que nous ne l’imaginions d’en bas.
Nous nous y voyons en garnison, à attendre pendant des temps interminables l’ennemi qui ne viendra pas.
Toujours il pleut la nuit. C’est bien. Parfois il pleut encore au petit matin. L’après-midi, le soleil continue à percer à travers les nuages depuis des jours. La pluie conserve la douceur, c’est bien connu. J’ajoute seulement une petite bûche dans les braises de la nuit. Il fait encore bon dans la maison.
Je laisse passer le temps. Les chaises doivent encore être humides devant le restaurant près du lac. J’y ai rendez-vous pour déjeuner avec Nadina. Je veux l’interroger encore sur l’exposition coloniale des surréalistes. Elle a fini par en apprendre plus que moi ; elle est docteur maintenant, pas moi.
Quand je sors, le soleil inonde déjà la façade de la maison. Des grappes de brume flottent encore au-dessus de la ville entre les toits. Le jour les rosit discrètement.
Je me souviens d’un Jésus en plastique qui remuait la tête quand on déposait une pièce dans la soucoupe placée devant lui. Je m’en souviens très bien comme si je l’avais encore devant moi ; à moins peut-être que je ne le rêve.
Depuis quand déjà Dirac a été construite ? Deux-mille ans, deux-mille-cinq-cents ans ? Non, je me souviens, deux-mille-trois-cents ans. C’était le temps des royaumes grecs de Transoxiane. J’ai tout oublié de la brochure que j’avais ramenée du musée. La ville d’où je viens a la même origine, mais elle est plus ancienne.
Les Dirakin ont vite tourné le dos aux dieux pour leur préférer le Bouddhisme. C’était le temps où des moines venaient prêcher la doctrine des anciens dans le Khorassan. Un livre d’entretiens d’un moine hindi avec le roi grec Ménandre en est resté célèbre.
C’était le temps des sculptures grecques, des sculptures de Bouddhas de style grec. Il en reste en quantité à Dirac, bien que la plupart aient été délibérément détruites. L’on en trouve des fragments dans toutes les fondations.
Il devait bien y avoir quelque-chose avant la fondation de Dirac. Je ne me souviens plus de ce qu’en disait le guide. Peut-être n’y avait-il rien. Il n’y avait rien sur le site de Massalia, mais elle fut fondée sur un rocher inhospitalier qui ne pouvait intéresser qu’un peuple de la mer pour sa crique abritée.
Le site ici est accueillant, propice à l’agriculture, facile à protéger. Il est dur de croire qu’il était encore désert au troisième siècle.
Sinta a répondu patiemment à toutes mes questions. Plutôt que de m’accompagner au musée où je voulais retourner, elle m’a conduit dans le plus ancien sanctuaire de la ville, un oratoire musulman. Ce n’est qu’une minuscule construction de pierre. On ne s’y tiendrait pas plus qu’à deux personnes.
L’on pense qu’il fut d’abord un lieu de culte zoroastrien, à cause de la façon dont il fut conçu pour que la fumée s’en échappe. Maintenant on y trouve un poêle dont le tuyau rejoint la cheminée du toit. Quelque bûches sont disposées à l’entrée, quelques branches cassée, quelques pignes. C’est appréciable par ce temps qui est devenu froid.
L’on ne trouve aucune serrure à la porte et n’importe qui a le droit d’y entrer. « Tu peux y venir toi-même si tu veux prier, méditer, t’y recueillir », me dit Sinta.
« Restons un peu », dis-je, le lieu me plaît. » Il est un endroit idéal pour plonger en soi-même. Quoi que fermé, il est percé de fenêtre étroites sur toute sa hauteur, soutenues par des colonnes de pierre.
Le site est ensoleillé, et la lumière y est assez abondante à travers les vitraux, du moins pendant le jour. Sinon, des cierges sont rangés dans un coin. Un étroit tapis, propre et neuf, est posé par-terre.
© Jean-Pierre Depétris, août 2023
Copyleft : cette œuvre est libre, vous pouvez la redistribuer et/ou la modifier selon les termes de la Licence Art Libre. Vous trouverez un exemplaire de cette Licence sur le site CopyleftAttitude http://www.artlibre.org ainsi que sur d’autres sites.
Adresse de l’original : http://jdepetris.free.fr/Livres/Sint_II/