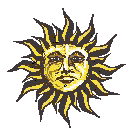
Carnet d’automne
Jean-Pierre Depetris, septembre 2019.
La maison d'Hannah - Dominique - Les rêves des poulpes - Un orage - Suite…
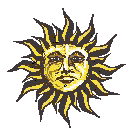
Jean-Pierre Depetris, septembre 2019.
La maison d'Hannah - Dominique - Les rêves des poulpes - Un orage - Suite…
Trop d’hommes pissent à côté du trou. Ce sont des timides, qu’ils le sachent ou non. Il est facile de viser juste dans les toilettes, il suffit de ne pas craindre de faire du bruit. Moi, je n’ai pas peur de faire du bruit quand je pisse, même dans les toilettes d’un lieu public quand j’ai remarqué que la cloison est fine. Pourquoi chercherais-je à cacher ce que chacun se doute que j’y suis venu faire ?
C’est à quoi je pense pendant que je parcours la route en lacets qui suit la côte rocheuse. On s’y sent éloigné de tout. Dans le rétroviseur, on ne distingue plus la ville derrière le cap. Le minéral est partout, couvert par plaques de buissons ras, parfois de pins d’Alep qui rampent presque par terre. C’est à cause du vent.
La couleur des arbres et des buissons est très sombre sur la roche blanche, striée de fentes noires et de minuscules rigoles tracées par la pluie et les embruns qui la rongent. La mer agitée depuis quelques jours a les mêmes contrastes entre les profonds turquoises et l’écume. Le ciel aussi, très chargé ce matin.
Si ce n’était la petite route sinueuse mais bien goudronnée, on ne verrait nulle trace de vie humaine d’ici, même pas le minuscule village qui va surgir derrière un virage ou deux : quelques maisons et leurs jardins dispersés autour d’une ruelle jonchée de graviers qui frappent sous l’habitacle, et que la route plus carrossable contourne d’un arc de cercle.
Malgré la vétusté de la voiture, le moteur tourne bien, et ses reprises nerveuses permettent de négocier agréablement les virages. L’embrayage est bien réglé, comme s’il était neuf, encourageant la conduite sportive. Les automobiles récentes sont plus molles.
Pourquoi ai-je pris un café au bar tout à l’heure pour pisser alors que j’aurais pu m’arrêter n’importe où dans les derniers kilomètres du trajet ? Peut-être ai-je craint qu’un orage ne me surprenne, ou ai-je voulu me laisser un délai avant de goûter ce lieu sauvage si près pourtant de la ville ?
Son littoral est étendu, il fait le tour entier de la rade, et même un peu plus puisque, passé le cap, sur la route sinueuse que je parcours, je reste encore dans l’un de ses arrondissements.
La ville a le secret de se ménager des espaces sauvages. Je me fais un plaisir de la photographier de ces endroits où, précisément, on ne la voit plus, où l’on se croirait à la campagne : un mur de jardin derrière lequel on aperçoit les montagnes décharnées, une petite église au milieu des pins derrière lesquels apparaissent la mer et les nuages. J’ai toute une collection de photos qu’on croirait prises dans les points les plus reculés du monde, certainement pas dans les arrondissements les plus centraux d’une ville quand même assez grande, au cœur d’une Europe vieille et surpeuplée.
Le littoral passe de plages modernes à des calanques où demeurent des villages qui ne sont plus ceux de pêcheurs – on a concentré la flotte de pêche dans un nouveau port camouflé derrière les installations portuaires pour laisser la place aux plaisanciers –, mais en conservent toutes les apparences.
J’ai pris justement un café avec Dominique hier en face de la mer, là où l’on ne trouve que des rochers où viennent se briser les vagues, et donc peu de baigneurs. Un petit bar de quartier, mais avec une belle terrasse de bois sur le large trottoir, et entouré de plusieurs autres parmi des magasins divers.
J’ai même trouvé un marchand de journaux tout proche. On n’en voit presque plus dans les villes normales : un vrai marchand de journaux, avec un choix de titres comme il n’en est plus que dans les grandes gares et les aéroports. J’y ai trouvé le Monde Diplomatique, le Harold Tribune, et même le Monde Libertaire, et encore Planète Linux.
La maison d’Hannah se situe nettement en dehors du dernier village de pêcheurs. On doit parcourir à pied les deux dernières centaines de mètres, et monter un escalier grossièrement taillé dans la pierre. L’escalier descend aussi jusqu’au niveau de la mer à un semblant d’embarcadère, où aucune embarcation n’est amarrée. Hannah n’a pas de bateau. C’est un bon endroit pour piquer une tête de bon matin.
Moi, je préfère entrer doucement dans l’eau, et apprécier la lente sensation de submersion. J’en éprouve une impression d’intense purification au petit jour, dont je suis sûr qu’elle n’est pas étrangère à celle que connaissent ceux qui se baignent dans le Gange. Piquerait-on une tête dans le Gange ? Sérieusement ?
La mer y est toujours fraîche. Passé le cap, la côte s’enfonce très vite jusqu’à des profondeurs considérables. La grande rade, jusqu’au cap, est peu profonde. Elle est une plaine sous-marine sableuse seulement traversée par une faille qui permet aux navires de haute mer de rejoindre l’entrée du port entre des îlots rocheux.
La maison d’Hannah a un étage mais elle n’est pas bien grande, d’autant que le rez-de-chaussée est largement absorbé par la déclivité du terrain. Quelques arbustes poussent autour, quelques figuiers de barbarie, mais il n’est pas assez de terre pour cultiver ne serait-ce qu’un petit potager. On trouve juste un petit plant de tomates contre le mur de la cuisine aux abords de l’escalier.
Le toit est une large terrasse. Pas besoin de pente ; ce n’est pas la neige ici qui le fera s’effondrer. Nous en profitons surtout après la tombée du jour, ou à la pleine nuit pour y contempler le ciel et y reconnaître le parcours des étoiles.
Les murs épais de la maison d’Hannah font rêver à un poste avancé fortifié protégeant l’accès de la rade de quelque flotte barbaresque.
La petite route côtière serpente par endroits jusqu’à peine au-dessus de la mer, et par vent fort, je dois mettre les essuie-glaces. Elle s’élève plus loin jusqu’au bord d’une falaise. Elle grimpe, elle descend, et traverse un autre village avant d’arriver au dernier.
On distingue parfois les ruines de vieilles batteries qui défendaient bien l’entrée de la rade, mais certainement plus d’une flotte barbaresque. Elles datent au plus de la fin du dix-neuvième siècle. Il en est une au-dessus de la maison de Hannah. Ce passé récent semble aujourd’hui étonnamment lointain.
Le lieu fut un temps davantage peuplé, en témoignent quelques ruines industrielles dont on s’étonne qu’elles se soient installées si loin au sud-est de la ville, si loin du port, si loin de tout réseau ferré, et même de routes aisément carrossables. Le quartier devait donc être plus peuplé, mais pas considérablement semble-t-il.
On ne peut rien faire d’un tel lieu trop sec, trop rocheux, fouetté par les vents et les embruns, à l’étroit entre la côte rocheuse et des massifs qui s’élèvent très vite tout droits en falaises escarpées, si ce n’est y abriter quelque association de plongée ou d’alpinisme.
Seul l’avant-dernier port devient vivant les nuits d’été en fin de semaine : quelques restaurants, un dancing, qui attirent un public plutôt populaire. Les salles éclairées, les lampions, la musique même, y peinent à disputer leur part à la nuit.
On entend les insectes la nuit chez Hannah. On se demande comment ils parviennent à vivre là. Ils composent avec le bruit des ressacs. La pleine lune fait scintiller l’écume et découpe les îlots rocheux du cap.
« Une légende veut qu’on ne connaisse rien à opposer à la démocratie qui ne soit plus autoritaire » dit Hannah. « Il ne semble pourtant pas douteux qu’en d’autres temps il y eut plus d’imagination. Les démocraties réelles sont déjà bien autoritaires, intrusives, policières…, et si l’on veut, totalitaires, pour qu’on soit incapable d’imaginer mieux. Pourquoi ne sait-on plus imaginer que pire ? Au moment même précisément où les démocraties ont échoué ? »
C’est ce que me confie Hannah pendant que nous prenons le café dehors devant la cuisine du rez-de-chaussée, en face d’un ciel qui est passé du rouge à un bleu qui s’épand sur toute chose, et teinte étrangement la vitre d’une éclatante lueur indigo.
En septembre, le coucher du soleil redevient visible de la cuisine, après s’être caché opportunément derrière le mur de gauche pendant les grosses chaleurs.
Je me surprends, comme toujours quand je me relis, à voir combien je m’encombre de digressions sociologiques. M’intéresse pourtant bien davantage la minéralogie. Quoi qu’on en dise, ce ne sont pas dans des rapports sociaux que nous visons, mais dans nos rapports avec la réalité minérale.
Nous, les humains ? Nous les vivants, plutôt.
J’accorde grand prix à cette impression de me sentir au bout du monde quand j’emprunte la route sinueuse au matin, en revenant de la maison d’Hannah. Elle signe Hannah, seulement Hannah, mais elle a peut-être reçu le prénom Ana, ou encore Anne. Je ne l’ai jamais interrogé sur ses origines lointaines. Le prénom Hannah a une belle symétrie. Dans une glace, Hannah est toujours Hannah. J’accorde grand prix à son hospitalité qui me permet tous les jours ce grandiose trajet.
Je le fais parfois à pied ; il ne doit pas y avoir beaucoup plus de trois kilomètres, puis j’emprunte les transports en commun. Il y a bien un petit bus qui fait la navette sur la dernière partie du trajet, mais je n’aime pas attendre car il passe peu fréquemment. De toute façon, je préfère marcher. Je sens mieux le lieu avec mes narines et ma peau. Il peut arriver qu’un automobiliste me propose de me conduire jusqu’à l’arrêt de la ligne qui parcourt une bonne part du littoral avec une plus grande fréquence, ou plus loin.
On sent la brise marine sur sa peau, les odeurs des algues et de la végétation. La mer est parsemée d’îlots de différentes tailles qui s’élèvent très haut comme des crocs dans le prolongement du cap. Une fois qu’on l’a dépassé, on ne distingue encore que par endroits la ville. Le matin, entre sept et neuf heures, on a l’espace illimité pour soi. Il est rare d’y croiser quelqu’un.
L’arrivée de l’automne est une belle saison ici. L’eau ne s’est pas encore refroidie et le feu du soleil ne brûle plus la peau. La proximité de la mer tiédit les aubes et adoucit les après-midi. Les herbes qui avaient séché se remettent à fleurir alors que des feuillages commencent à prendre des teintes rouge vif ; et ceux jaune clair des micocouliers, à joncher les places.
J’ai déjeuné avec Dominique au restaurant devant la petite plage, là où est la place d’où part la jetée, et où des foires s’installent souvent, avec des autos tamponneuses et des baraques de tir. Elle n’est pas bien large, et l’on ne voit presque pas le sable de la hauteur de la rue. S’y trouvent encore des baigneurs, beaucoup moins bien sûr qu’à la pleine saison. Elle y gagne une sensation de paix ; même les joueurs de hand-ball semblent se mouvoir lentement, comme des Chinois qui pratiquent le Chi Gong.
« La fonction très décorative de locataire de la Maison Blanche a été bouleversée par Tweeter », ai-je dit à Dominique. Elle n’en croit pas un mot – je n’avais pas précisé que Dominique est une femme.
« Le tweeter de la Maison Blanche semble pourtant bien s’être donné un pouvoir que n’avaient pas les autres locataires. – Rappelle-moi combien de signes il est possible d’employer dans un message ? » m’interroge Dominique ironique. « À ce compte, le style et l’impeccable diction d’acteur shakespearien du précédent auraient pu mieux faire. »
« Alors pourquoi n’a-t-il pas fait mieux ? L’État profond ? »
« L’État profond, ce n’est qu’une façon de parler. Il existe bien une administration et des appareils qui préexistent aux législatures et leur survivent ; qui survivent aux gouvernements. Il ne serait d’ailleurs pas si facile de démontrer que ce soit finalement une chose contestable. Ce sont des gens évidemment, souvent de vieux routiers dans leurs domaines, mais ce sont surtout des formes d’organisation, des façons de fonctionner, littéralement des appareils, et même des appareils automatiques. Comment devrait-on les appeler ? Mais ce n’est pas la peine non plus d’en dénoncer l’existence sur un ton complotiste. L’État profond est d’ailleurs bien capable de fomenter ses propres complots, et à multiples détentes, et dont il ne sait peut-être pas toujours qu’il les a fomentés. »
Dominique voit bien que cette conversation que j’ai lancée moi-même, m’intéresse moins que la géologie. Les rapports qu’entretient la vie avec le sol sont plus pragmatiques et lucides que ceux, plus ou moins hallucinés, que produisent les sociétés d’êtres vivants.
On nettoie la cuisine au jet chez Hannah. C’est la première fois que je vois une chose pareille. L’eau s’écoule sur le carrelage jusqu’à une petite grille sous la fenêtre pour sortir devant la façade près du plant de tomates.
Au fond, Dominique a raison. Comment arrive-t-on à s’intéresser à des personnalités qui font en l’occurrence principalement fonction de leurres ? Des leurres de la puissance. Ils ne servent même pas à cacher de véritables détenteurs du pouvoir, mais à en masquer l’absence ; l’impuissance généralisée.
Pas de mépris toutefois. Nous avons tous nos célébrités dont nous suivons avec plus ou moins d’intérêt les aventures : hommes politiques, acteurs, sportifs, mais aussi philosophes, écrivains, chercheurs… Toute personne est par ailleurs fascinante pour peu qu’on apprenne des détails de sa vie, même si ça ne fait pas vraiment fonction de critiques littéraires ou autres.
Pouvons-nous cependant être fasciné par quelqu’un que nous ne fascinons pas ? Les célébrités prennent vite dans notre esprit la place de proches, fussent-ils des proches que nous n’aimons pas. Nous voyons si souvent leurs photos, leurs vidéos, qu’ils nous semblent intimes. Peut-on ressentir une intimité qui ne soit pas partagée ? Moi, non ; pas longtemps du moins, juste le temps de me laisser distraitement prendre, juste le temps de songer, par exemple, à écrire ou à appeler, et de me sentir bête.
Des rencontres s’effectuent pourtant quelquefois, le plus souvent par courriel, et il se peut que nous découvrions que nous avons bien quelque chose à nous dire…, à parler de ce que nous faisons, nous interroger…, et dans ce cas alors la célébrité reste au vestiaire.
Curieusement, ce phénomène de célébrité a gagné et perdu à la fois de l’importance depuis le vingtième siècle. Il en a gagné grâce à l’internet qui lui permet de pénétrer plus profondément dans notre vie intime et nos relations, et qui la hiérarchise bien au-delà du bon sens, mais on en est en même temps moins dupe. Dans ma jeunesse, je prenais bien plus au sérieux le coefficient de célébrité des gens que je connaissais, ou le plus souvent que je ne connaissais pas. Je tentais d’obtenir d’eux une reconnaissance, ou encore une part de leur autorité en les citant. Les mœurs universitaires, militantes, littéraires…, nous y encourageaient, et même nous y formaient. Tout ce que nous disions s’adossait à l’autorité de quelques célébrités. Je continue bien un peu, mais la conviction n’y est plus. Je ne peux plus, comme je prisais Michel Serres pour avoir écrit Hermès, l’admirer toujours en le voyant jouer à la télévision le rôle du grand-père que je n’ai pas eu. Je ne vois même plus l’utilité d’obtenir la reconnaissance de quiconque, ni d’être davantage connu ou publié.
L’État profond, lui, est discret et anonyme, et c’est pourquoi peut-être, on n’y songe qu’aujourd’hui.
Oui, Hannah nettoie sa cuisine au jet d’eau. Je ne connais rien de plus pratique pour bien dégraisser les carrelages. J’ai toujours rêvé de pièces carrelées de céramique qui se nettoieraient au jet, avec un grand bassin à ciel ouvert au mitan de la maison. J’ai été très surpris le premier jour où je l’ai vue faire.
Hannah ne doit pas manquer de courage pour habiter seule en un tel endroit. Les environs ne sont pas toujours bien famés la nuit. En fait ce ne sont pas à ces choses que je pense ; plutôt au vaste ciel et à la mer immense, aux bruits lointains des éléments. Je connais bien des hommes solides qui ne se sentiraient pas rassurés ici en pleine nuit, dans l’obscurité à peine trouée de la lueur des étoiles, et des éclats de l’écume.
J’ai connu Hannah par Dominique, et Dominique en la lisant. J’étais tombé par hasard chez un bouquiniste sur une revue de gauche radicale. Elle y avait écrit un article sur la conception du dépassement de l’art chez les Situationnistes, qui m’avait donné à réfléchir. Il y avait l’adresse de son site et je suis allé y voir. Nous avons correspondu et j’ai découvert avec surprise qu’elle était une femme. Elle avait choisi son second prénom pour son nom de plume afin qu’il laisse planer le doute sur son genre. Cette sorte d’article, on ne pense évidemment pas que ce soit une femme qui l’ait écrit.
La maison d’Hannah est à peine habitable. Mal isolée, elle doit être froide en hiver. Je le saurai bientôt si je reste. Elle dispose cependant d’un ingénieux système de chauffage, solaire et éolien, conçu et installé par un ami ingénieur.
Le ciel est rarement couvert dans la région, et toujours soufflent des vents forts autour du cap. Les murs épais gardent bien la chaleur et permettent de tenir un certain temps sans soleil ni vent. Il n’y a rien cependant autour pour faire un feu de bois.
Hannah ne craint pas le froid. Il est vrai qu’elle est plus jeune que moi, mais quand même. Quand le vent est fort, comme il est fréquent, les courants d’air qui se faufilent autour des fenêtres fermées font bouger les rideaux. En fin septembre, ce n’est pas désagréable, mais je redoute l’hiver.
Une turbine est fixée sur un rocher bien orienté en aplomb du toit en terrasse. Elle est reliée à un générateur dans une niche de ciment contre la maison. Les plaques solaires sont placées aussi à proximité, fixées aux roches. Me chagrine que rien ne pousse autour, si ce n’est quatre plants de tomates et deux figuiers de barbarie, et aussi un figuier rabougri qui ne donne pas de figues. Tant de terrain où ne poussent que des cailloux !
Il reste pourtant bien quelques poissons près des rochers. Ils viennent me narguer quand je nage sans fusil, mais quand j’en prends un, on ne les voit plus. Je n’ai attrapé qu’une grosse dorade et un muge depuis que je suis ici. Pour deux, ça ne fait pas des festins.
J’aime penser que j’ai de quoi manger autour de moi là où je vis sans devoir passer par le commerce. J’y trouve un rapport particulier avec le lieu. On voit encore des huîtres, des moules et des oursins, et des crabes, bien sûr, que j’apprécie plus modérément.
Je ne supporte pas de tuer des poulpes, sinon, on en trouve aussi. Ils ont trop d’intelligence dans le regard, et trop d’élégance dans le mouvement. Non, je n’en aurais jamais le cœur.
Si je veux continuer à plonger, il serait temps que je me cherche une combinaison. Hannah ne pourrait pas me prêter la sienne, je n’y entrerais pas. Elle fait une bonne tête de moins que moi, et est plutôt osseuse.
Hannah juge son physique ingrat, ce qui est un point de vue que je ne partage pas. En conséquence, probablement, elle a renoncé à tout effort pour paraître belle : un simple pantalon de toile, une chemise aux manches retroussées sur les coudes, des cheveux mi-longs négligemment rejetés en arrière, aucune trace de maquillage, pas même une chaîne autour du cou.
Quand je l’ai vue pour la première fois, j’ai tout de suite aimé son regard. Son regard – comment dire ? – paraît regarder de loin, attentivement, mais de loin, de trop loin pour qu’il soit déjà question d’un signe de reconnaissance. D’aucuns le diraient peut-être inexpressif, oui, mais dans le sens où il n’a rien à exprimer, à dire tout au plus. Un regard qui attend, qui est attentif, et discrètement contemplatif. Hannah fait parfois la grâce d’un sourire, un sourire d’une rare beauté, quoique léger.
Bien qu’elle soit plutôt vive, plutôt énergique dans ses gestes et ses mouvements, elle ne se départit jamais d’une légèreté, ni d’un air contemplatif. On pourrait l’imaginer pratiquant quelque art martial d’Extrême-Orient, mais c’est la musique qu’elle pratique, les cordes. On trouve dans la grande chambre du premier, ou parfois oubliés dans l’appartement, plusieurs guitares, un oud et un târ persans, un ruan chinois, un shamisen japonais, une dombra mongole.
J’ai appris que les poulpes sont capables de changer de couleur en rêvant. Ils dorment, et leur couleur se modifie. C’est la preuve que leur homochromie n’est pas une réaction automatique de leurs chromatophores sous l’effet de l’environnement, mais qu’elle est provoquée par leur esprit. On voit ainsi les changements du milieu dans lequel la pieuvre se déplace en rêve.
Après ce que j’ai appris des pieuvres, je me rends attentif quand je nage sous l’eau, à ne pas en ignorer une rêvant, endormie parmi les roches ou sur le sable. Apparemment, elles ne dorment pas quand je glisse silencieusement sous l’eau, et que je ne les vois pas. Je dois bien en frôler quelques-unes qui demeurent inexorablement camouflées.
Je vois moins encore de seiches. Je sais qu’il y en a, probablement mieux camouflées encore, semblables à des galets sur le sable. Je suis bien obligé d’abandonner mes lunettes de vue quand je nage. Sans elles, je ne distingue plus grand-chose. Je deviens toutefois plus sensible aux mouvements et aux distances. Je crois que je chasse mieux sans lunettes. Si les poissons le savaient, ils se tiendraient immobiles, et je ne saurais pas les distinguer d’un bois mort ou d’une algue entre deux courants, ou d’un sac en plastique.
Le plastique envahit les mers et ne fait pas du bien à la faune qui l’ingère. Les gens payés pour prendre les bonnes décisions à la place des autres ont aussi sec pensé à produire des sacs en plastique biodégradables. Tout aussi immédiatement quand je l’ai su, j’ai pensé que c’était une imbécillité. Biodégradables, ils ne cessent pas d’être de la matière plastique, et ils polluent plus encore en s’insinuant partout. Je ne sais où l’on va chercher les gens payés pour prendre les bonnes décisions à la place des autres, peut-être à l’École Nationale d’Administration, mais probablement pas à l’École des Mines.
J’avais rangé des composants électriques et des câbles USB en surnombre dans un tel sac. Quand je suis retourné y chercher, la poignée m’est restée dans la main, et il s’est délité en confettis répandus parmi les câbles sur le sol de la cave, m’arrachant un chapelet d’injures contre ceux qui sont payés pour prendre les bonnes décisions à la place des autres.
Il fait froid maintenant le matin. La température de l’eau ne m’encourage plus à me laisser lentement submerger. Elle offre une expérience plus brutale. Au point du jour, sa fraîcheur n’est peut-être pas plus mordante que celle de l’air, mais assurément plus pénétrante. Elle réveille les douleurs de vieilles fractures. Elle demeure malgré tout une expérience agréable. Nager l’après-midi, ce n’est plus du tout la même impression qu’au petit jour, le corps encore couvert de la douceur des draps, l’âme, de sommeil, et l’esprit, de rêves.
« Penser, c’est dire non » écrivait Alain. « Le signe du oui est d’un homme qui s’endort ; au contraire, le réveil secoue la tête et dit “non”. Non à quoi ? Au monde, au tyran, au prêcheur ? Ce n’est que l’apparence. En tous ces cas-là, c’est à elle-même que la pensée dit non. Elle rompt l’heureux acquiescement. Elle se sépare d’elle-même. Elle combat contre elle-même. Il n’y a pas au monde d’autre combat. Ce qui fait que le monde me trompe par ses perspectives, ses brouillards, ses chocs détournés, c’est que je consens, c’est que je ne cherche pas autre chose. Et ce qui fait que le tyran est maître de moi, c’est que je respecte au lieu d’examiner. Même une doctrine vraie, elle tombe au faux par cette somnolence. »
Voilà une forte pensée tirée des Propos sur les pouvoirs, de 1924. Elle marque pourtant ses propres limites, celles du rationalisme, disons. Elle suppose que la pensée se fonde d’abord sur de la pensée. Elle suppose d’avoir entendu « je pense donc je suis », comme s’il s’agissait du verbe « suivre », non pas comme « il pense donc il est », mais comme « il pense donc il suit ». Je peux bien alors dire « non », ce ne sera jamais que des dénégations. Je pense plutôt lorsque j’éprouve et expérimente.
La remarque d’Alain demeure forte cependant par sa conclusion : « Même une doctrine vraie, elle tombe au faux par cette somnolence. » J’ai tant de fois expérimenté, sur moi comme sur les autres, que ce que nous savons et sommes capables d’expliquer ne nous aide pas vraiment lorsque nous sommes au pied du mur, et même nous handicape bien plus qu’un esprit vide. Dans le fond, il me semble que l’esprit qui s’endort ferait mieux carrément de rêver, comme les pieuvres aux couleurs changeantes.
J’ai encore une fois rejoint Dominique pour un café en fin d’après-midi. Nous nous sommes retrouvés à la dernière grande plage au Sud. En fait, elle n’est pas si grande, mais elle le paraît aujourd’hui, tant elle est déserte.
Il fait un temps magnifique d’avant l’orage. Un vent fort du sud-ouest pousse les nuages bas au-dessus de nos têtes. À l’horizon, le ciel est presque noir, et derrière nous, il masque les cimes déchiquetées du massif. Je n’ai pas très chaud à l’une des dernières buvettes encore ouvertes, avec ma veste de pêche sans manche et une chemise légère. C’est à cause du vent du large, car à l’abri, il ferait plutôt tiède et lourd. Il soulève de petites franges de sable sur la plage.
Je suis venu à pied de chez Hannah, ce qui fait un trajet considérable, mais agréable en longeant la rue principale, avec toutes ses ruelles perpendiculaires qui descendent sur la mer ou montent vers les hautes pinèdes. J’ai cependant négligé les risques d’orage. Le ciel n’était pas encore bouché quand je suis parti.
Je trouve que Dominique se préoccupe bien trop du sort des pauvres. Mieux vaut laisser ça aux catholiques. Les catholiques se sont fait du sort des pauvres une raison d’être. Le souci de la pauvreté contamine depuis trop longtemps la lutte des classes, prétextant que beaucoup de travailleurs sont pauvres, justement, et oblitérant que le fait important n’est pas leur pauvreté, qui, pourrait-on dire, est l’accident, mais qu’ils travaillent. Ils travaillent le monde, ce qui constitue, disons, leur essence. Leur pauvreté éventuelle et relative est tout au plus la mesure du peu de pouvoir qu’ils exercent sur les procès de travail.
Voilà ce que j’ai reproché à Dominique. « Reprocher » est un mot fort, et « mettre en garde » plus encore. Disons que je lui ai fait part de mon étonnement.
Il me semble que si l’on voulait vraiment combattre la pauvreté, on prendrait les mesures radicales qui finiraient bien par la faire disparaître. De route façon, je me refuse à ne voir dans la pauvreté que ses côtés néfastes. C’est oublier un peu vite qu’elle accompagne la voie du détachement. Toutes les écoles de sagesse le savent.
Mes critiques ont amusé Dominique. « Bien sûr, » m’a-t-elle répondu, « le pouvoir d’achat n’est pas le pouvoir des soviets. – Eh bien alors ? » Ai-je insisté.
Pour me faire bien comprendre, j’ai évoqué l’incendie toxique de l’usine de Rouen ces jours derniers. Deux personnes étaient tenues de connaître exactement la nature des risques et la toxicité des émanations : le directeur et le préfet. S’ils avaient assuré leurs fonctions, les réponses auraient dû leur être à portée de tiroir. On les interroge, et ils restent hagards. Non, ils ne sont au courant de rien.
Les travailleurs, les ingénieurs de l’usine, en sauraient-ils plus ? Ceci est la question à se poser : s’ils savent, alors qu’ils prennent le pouvoir d’informer et de prendre des décisions. S’ils ne savent rien, alors qu’ils prennent le pouvoir sur le procès de travail qu’ils accomplissent. Il n’y a pas d’autre question. Qu’ils soient plus riches ou plus pauvres n’en est qu’un épiphénomène.
Notre conversation ne m’a pas empêché de demeurer attentif à l’évolution de la masse nuageuse et du vent, des tons de la mer et de la direction des vagues, d’abord par crainte de devoir parcourir le long chemin pour rentrer chez Hannah sous une pluie battante, puis toujours plus fasciné par leur beauté.
Dominique m’a très vite rassuré en m’apprenant qu’elle avait pris sa voiture, et qu’elle pourrait me ramener. Je ne déteste pas marcher sous la pluie, ni même sous l’orage, mais à la condition de ne porter sur moi rien qui craigne l’eau, comme un carnet ou une tablette. Je préfère aussi dans ce cas, me passer de mes lunettes et les enfermer dans un étui étanche.
J’étais venu rapporter à Dominique un article qu’elle m’avait confié pour que je le relise avant qu’elle ne l’envoie pour publication. Nous fonctionnons souvent ainsi avec quelques amis, tenant lieu les uns pour les autres de comité de lecture. C’est un procédé très efficace, et pas uniquement pour les retours effectifs, mais parce qu’imaginer cette lecture par des proches, pour tout dire des égaux, donne une vigilance et une acuité critique que n’inspirerait aucun véritable comité de lecture. Inévitablement, juste avant de l’envoyer, vous découvrez des faiblesses ou des fautes qui vous auraient sinon échappé. Un véritable comité de lecture provoquerait plutôt l’effet contraire de trop se reposer sur lui pour les coquilles, les relâchements de style, et même de pensée.
Je lui avais déjà posté le texte annoté par courriel, mais je trouvais plus agréable d’en parler autour d’un café, dans ce paysage rendu inopinément grandiose par la saison.
Les gouttes ont commencé à tomber quand je descendais de voiture, de grosses gouttes très espacées, que le vent commençait à sécher avant même qu’elles ne trempent le sol et les vêtements. Depuis quelques instants déjà on entendait les tonnerres se rapprocher, et de magnifiques éclairs sillonnaient le ciel au-dessus de la mer. J’eus à peine le temps de parcourir les quelques centaines de mètres qui me conduisaient au perron, avant que la pluie ne se mette à battre, dégageant une forte odeur de pierre mouillée.
J’ai ôté mes chaussures, ma veste et ma chemise, et je me suis avancé un peu devant la porte pour voir l’état de la mer en contrebas. Pas question avec un tel ressac d’entrer dans l’eau, et surtout d’en ressortir sans se blesser. Je suis rentré déçu. C’est un temps excellent pour la chasse. Hannah jouait de l’oud dans sa chambre du haut.
Les pâtes au pistou, c’est très simple : une bonne poignée de spaghettis, deux ou trois tiges de pistou, plus communément appelé basilic, deux à quatre gousses d’ail, et de l’huile d’olive.
Pendant que l’eau est portée à ébullition, on hache le pistou avec l’ail. Plus on les hache fin, plus ils dégagent et mêlent leurs saveurs. Pour ma part, je préfère les hacher plus grossièrement pour le plaisir des yeux, et pour les laisser s’écraser sous la dent.
Dans un petit récipient, on verse quelques cuillères à soupe d’huile d’olive dans le pistou et l’ail hachés. On les mélange jusqu’à leur donner la texture d’une sauce. On la verse sur les pâtes quand elles sont cuites, et l’on sert avec du gruyère râpé.
C’est un plat très simple. Hannah et moi partageons un goût pour la simplicité. Certains préfèrent verser le pistou haché sur des tomates revenues à la poêle avec de l’ail. C’est bien aussi, mais pas assez simple pour nous. Nous préférons ne pas mêler trop de goûts.
Ce soir, c’est moi qui ai fait le chef, et Hannah s’est contentée de m’assister. Nous changeons à peu près chaque jour, partageant nos recettes.
Nous avons laissé les volets ouverts pour mieux voir et entendre l’orage. La nuit était tombée pendant que nous dînions près de la fenêtre, nous avons seulement éclairé pour débarrasser et nous servir un café sur la petite table où nous jouons quelquefois aux échecs.
Le roulement des tonnerres devenait continu par instants. Dans ce paysage minéral, éclairé d’une lumière vacillante d’arcs électriques, le peu de végétation était tordu et secoué en tous sens par les vents qui hurlaient. Nous avions placé des serpillières pour arrêter l’eau qui risquait de suinter des fenêtres mal isolées.
J’étais sorti débrancher l’installation électrique. Toute connexion était interrompue. J’en éprouvais un profond sentiment de paix. Nous étions loin de tout, invisibles, tranquilles, protégés par la fureur des éléments dans laquelle je m’abandonnais. Dehors, sur la pierre trempée, les éclaboussures des gouttes recouvraient tout d’une sorte d’aura transparente d’une douzaine de pouces.
Nous n’avions pas envie d’aller nous coucher. Hannah a fini par laisser tomber sa tête sur mon buste, et s’est mise à ronfler doucement comme un chat qui dort. Sans trop bouger, j’ai rabattu la couverture du divan sur son corps, et je n’ai pas dû tarder à m’endormir moi aussi.
Le froid m’a réveillé avant l’aube. Je me suis dégagé doucement. Le ciel dehors était pur comme s’il avait été lavé par la pluie. Le vent, qui avait tourné, était glacial.
© Jean-Pierre Depétris, septembre 2019
Copyleft : cette œuvre est libre, vous pouvez la redistribuer et/ou la modifier selon les termes de la Licence Art Libre. Vous trouverez un exemplaire de cette Licence sur le site CopyleftAttitude http://www.artlibre.org ainsi que sur d’autres sites.
Adresse de l’original : http://jdepetris.free.fr/automne/